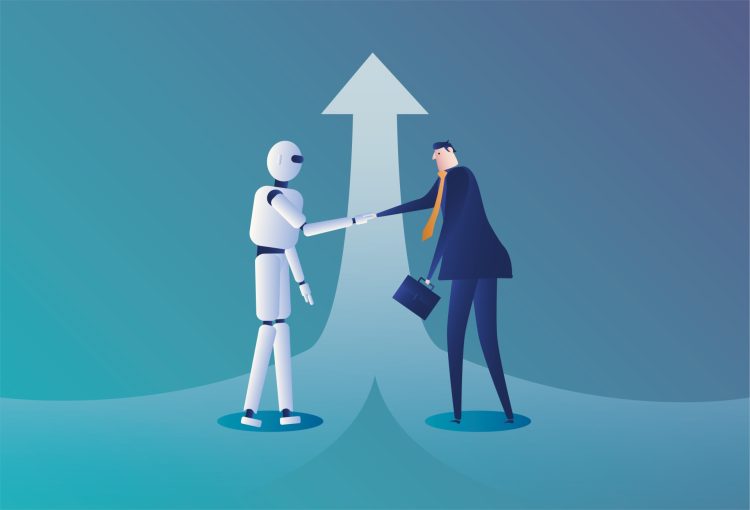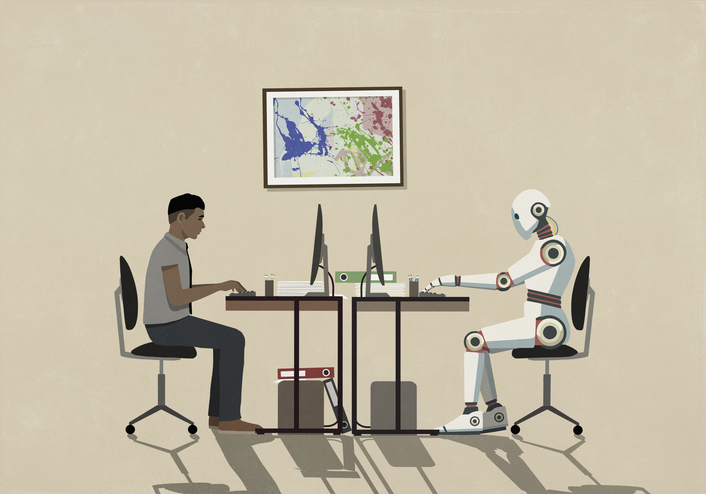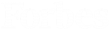À l’occasion des conférences Unexpected Sources of Inspiration (USI), Forbes France a pu rencontrer Ugo Bellagamba, maître de conférence en histoire du droit et auteur de science-fiction. Ce dernier nous décrypte comment les récits imaginaires spéculatifs peuvent nous aider à reformuler (ou penser) nos représentations de la souveraineté étatique, de la société et du monde technique, tout en n’hésitant pas à s’éloigner du probable. Entretien.
Nous avons exploré avec Roland Lehoucq tout récemment comment la science-fiction participe à la formation de nos représentations collectives du monde technique et de la souveraineté… Partagez-vous la même vision ?
Ugo Bellagamba : Je suis pour ma part historien du droit et des idées politiques, je ne suis pas spécialiste du droit positif ou bien de la tech en tant que telle. Mais ma vision de ces enjeux est assez similaire et je travaille aussi sur des innovations pédagogiques visant à renforcer le mode de formation de nos étudiants.
Il n’existe pas tant de juristes dans le milieu de la science-fiction (SF) et pourtant le genre s’intéresse bel et bien à l’organisation de la société, de la justice ou encore des institutions. Je dirais même que la société est un personnage à part entière dans la SF. C’est un laboratoire prospectif en tant que tel qui essaye de décrire comment la société, la politique et la technique peuvent évoluer, tout en n’hésitant pas à s’éloigner du probable.
Vous semblez de votre côté faire davantage référence à des auteurs plus anciens comme Thomas More et Thomas Hobbes… Qu’apprend-on de la souveraineté ?
U. B. : En effet, car la définition de la souveraineté se joue justement à partir de la Renaissance. La SF n’existe pas encore à cette époque mais des courants utopistes émergent déjà dans le creuset du XVIe siècle, notamment via Thomas More. De leur côté, Nicolas Machiavel et Thomas Hobbes se sont positionnés sur la nature du système politique et sur la notion de droit comme structure de légitimation du pouvoir. Ces concepts inspireront d’ailleurs les philosophes des Lumières comme Rousseau ou Montesquieu un siècle plus tard.
Certains estiment que l’utopie est née avec la République de Platon mais son père reste bien Thomas More, en 1516. Puis, le courant utopique se développe durant tout le XVIIIe siècle, marqué par de grandes transformations politiques, religieuses, techniques mais aussi par l’arrivée d’une vision plus cosmopolite du monde. Thomas More estimait que cette fiction, même si elle n’est pas crédible, permet « d’informer le réel » en pointant justement ce que le réel n’est pas. Le partage optimal des ressources, le primat de l’agriculture et l’égalité parfaite entre hommes et femmes dépeints dans L’Utopie sont une représentation critique du réel. Ce n’est pas l’annonce de ce qui va arriver, mais plutôt la liste de ce qui manque à son époque.
Ce raisonnement est à la racine du processus narratif de réflexion critique sur la société. Un laboratoire au cœur des réflexions au cours de la Renaissance, notamment sur la question de la souveraineté.
À l’époque de ces auteurs, la notion de souveraineté était bien différente… Comment l’appliquer aujourd’hui d’un point de vue politique et technique ?
U. B. : Les auteurs des Temps Modernes avaient perçu une chose évidente : la technologie modifie la structure de nos sociétés et la manière dont s’exerce le pouvoir souverain. On peut retrouver les mêmes phénomènes aujourd’hui avec la question de la surveillance technologique ou encore de la part croissante pris par les réseaux sociaux dans notre vie politique. Le sujet de la souveraineté technologique était aussi abordé par Machiavel dans Le Prince : dans le chapitre 14, il explique que celui qui connaît le mieux le terrain impose sa souveraineté, envisageant la connaissance technique comme une arme politique. Au cours de la Renaissance, l’invention de la balistique en 1537 par Niccolo Fontana Tartaglia a par exemple été au cœur de la course technologique entre les différents empires.
Machiavel et Thomas More ont aussi, chacun à leur manière, formulé une critique de l’hubris du Prince qui se détourne volontairement de la morale et la religion pour arriver à ses fins. Et cette thématique est largement abordée dans la SF, à travers notamment Dune de Frank Herbert ou encore Fondation d’Isaac Asimov. Appliquée au monde contemporain, nous pourrions postuler que la tech est souvent assimilée à du technosolutionnisme ou du transhumanisme. Mais si la SF est souvent accusée d’être technocentrée ou techno-optimiste, certains corpus de récits imaginaires peuvent aussi nous mener vers la piste d’une régression technique. Je pense par exemple à la disparition souhaitée des intelligences artificielles dans Dune. LA SF n’est ni technophobe ni technophile et c’est à nous de décider ce qu’il faut garder ou non.
En science-fiction, la présence d’un système politique autoritaire est assez récurrente… d’autres voies davantage démocratiques sont-elles possibles et souhaitables ?
U. B. : Oui, il existe un biais dystopique dans la SF car il est évident que les scénarios catastrophes sont plus excitants à lire. De la même manière, le récit mettant en scène un citoyen lambda qui se bat contre les rouages d’un système dictatorial l’est aussi. On peut citer à cet égard l’épisode de “l’Homme obsolète” dans la série télévisée des années soixante Twilight Zone : on y voit un bibliothécaire être condamné à mort par l’État pour ne pas être utile pour la société. Ici, le fait d’imaginer un système de justice plus égalitaire s’avère plus difficile : cela n’est pas vraiment crédible car tout le monde semble partager l’idée que notre système judiciaire n’est pas parfait.
Pourtant, les utopies de ce type existent : en 1771, le journaliste Louis-Sébastien Mercier a publié L’An 2440, rêve s’il en fut jamais, considéré comme le premier roman d’anticipation qui englobe la philosophie des Lumières dans une utopie lointaine. J’aimerais aussi faire référence à l’auteur William Morris qui a publié en 1890 News From Nowhere, une utopie en l’an 2102 où la société est profondément communiste et égalitaire. Dans ce monde, la sanction pénale n’existe plus et le système de réinsertion des délinquants se trouve optimal. En passant, William Morris était aussi un décorateur de renom et est connu pour avoir inventé le papier peint, un moyen pour les ouvriers de l’époque, sans congés, de transformer leur demeure en paysage bucolique.
Aujourd’hui peu d’auteurs traitent cette utopie et la représentation de la justice est souvent négative pour nous pousser à réagir et à l’éviter.
Vous affirmez qu’aucune dystopie n’a jamais eu vocation à se réaliser et pourtant le contexte d’incertitude dans lequel nous vivons (urgence climatique, contexte géopolitique instable, montée des extrêmes, polarisation du débat démocratique…) n’est pas très encourageant…
U. B. : La dystopie en principe ne se réalise pas plus que l’utopie. Toutes deux produisent des figures narratives qui n’ont aucune vocation à se réaliser, mais à nous interroger. Si nous craignons que ces scénarios se réalisent, cela signifie que nous confondons la fiction et le réel. C’est avant tout un laboratoire d’idées et l’annonce d’une catastrophe probable est justement stimulante pour la recherche d’alternatives et de solutions. Par exemple, le changement climatique est indéniable et nous devons tous nous retrousser les manches pour chercher à limiter son impact. Cette notion d’effondrement inarrêtable est par exemple traitée dans Fondation d’Isaac Asimov et ceux qui lisent ce type de SF sont bien plus acclimatés aux phases de crise, à la recherche de solutions crédibles.
Certaines organisations militantes pour le climat dénoncent un système politique et économique plongé dans une forme de déni de l’effondrement climatique… Est-ce aussi un sujet abordé par la SF ?
U. B. : Oui, et Machiavel avait déjà théorisé que l’essence même du politique est de se conserver et de retarder le plus possible le moment où l’empire chutera. L’accusation d’un système politique qui cherche à se conserver est limite infondée, car c’est dans sa nature même de le faire. Ainsi, la SF met souvent en scène des rebelles qui vont tout faire pour accélérer l’effondrement du système pour éviter que son agonie ne signe la fin du monde.
Mais d’autres courants comme le Solarpunk s’intéressent à la possibilité de réutiliser certains éléments technologiques ou juridiques du système contre lui-même. Yannick Rumpala par exemple a évoqué dans son essai Hors des décombres du monde les différents scénarios de la SF qui peuvent aider à imaginer les systèmes de demain. Le Solarpunk est un réservoir de possibilités pour répondre à l’urgence climatique et ce courant très récent de la SF se base sur deux principes fondateurs : la sobriété énergétique et technologique d’une part et un système de partage équitable des ressources d’autre part. Cela suppose donc moins de propriété pleine et entière et moins ou plus du tout d’accumulation de richesses.
Dans le même registre, Kim Stanley Robinson a récemment expliqué comment l’imaginaire de la SF peuvent aider à gérer des crises, de façon inattendue, en s’appuyant, par exemple, sur les banques centrales, alors qu’elles-mêmes sont un élément du problème. Il a aussi soumis l’idée de création du Carbon Coin, une cryptomonnaie dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique. La SF n’est donc pas hors sol et peut amener des réponses tangibles aux crises du monde réel.
La souveraineté et la gouvernance ne sont-elles pas un moyen d’éviter que les foules ne basculent dans les extrêmes ? Faut-il craindre un retour de l’autoritarisme ? Un sujet éminemment d’actualité en Europe…
U. B. : Il faut à mon sens distinguer deux choses : la souveraineté est un outil juridique et politique nécessaire pour assurer l’existence de l’État, tandis que l’autoritarisme est une utilisation idéologique de la souveraineté qui consiste à dire : suivez-moi ou sinon ce sera le chaos. Ainsi, la souveraineté est plus que nécessaire, mais il ne faut pas la ranger dans le même panier que l’autoritarisme et les extrêmes. Si nous devons choisir entre liberté et sécurité, on risque de perdre les deux. La souveraineté est justement un rempart à l’extrémisme et le fait de s’autoriser à suspendre des droits humains fondamentaux reste inacceptable.
Dans la série Silo ou le jeu vidéo (et série) Fallout, un système social est imposé pour assurer la préservation de l’humanité. Mais si ce système n’est pas légitimé aux yeux du peuple, cela ne peut durer.
Devrait-on retirer à l’État le « monopole de la force légitime » (au sens de Thomas Hobbes) ?
U. B. : En tant que juriste, je ne peux qu’affirmer que ce monopole est la moins pire des solutions face à la violence tout court. Dans un système démocratique, si on retire à l’État ce monopole, on lui enlève le moyen d’agir en vue du but de préservation pour lequel il a été initialement créé. La seule violence acceptable dans une société reste celle publique et celle-ci existe justement pour nous protéger. John Locke expliquait à ce titre que la justice est là pour exercer à notre place la demande de réparation et d’assumer la contrainte pour l’obtenir.
Maintenant, le droit de manifestation est tout aussi fondamental et il y a une certaine légitimité dans la façon dont revendiquent les gilets jaunes ou encore les Soulèvements de la Terre, par exemple. Ces mouvements se nourrissent d’urgences sociales et environnementales évidentes. C’est donc toujours un problème de voir des manifestants se faire violemment réprimer par les services de police car une grande partie du peuple n’a plus confiance en l’État et si ce dernier ne réprime pas toutes les formes de violence, il peut rapidement perdre sa légitimité.
Dans le Ministère du futur, des mouvements terroristes parviennent à faire s’écraser des avions de ligne, faisant de nombreuses victimes. S’ensuit une période de peur généralisée et une chute drastique des revenus du secteur aérien. La position des terroristes est radicale : ils proclament agir pour l’écologie et affirment que les centaines de morts provoquées ont permis de préserver la vie de millions d’autres. Ici la violence est nécessaire pour changer la société mais elle n’est jamais acceptable d’un point de vue juridique, à l’échelle des droits humains fondamentaux. Et quoi qu’il arrive, si le monde bascule, le droit finira toujours par s’adapter avec de nouveaux repères.
Roland Lehoucq développe l’idée des “right tech” comme “la technologie au bon endroit, au bon moment et qui répond à une question pertinente”… ce concept peut-il s’appliquer au domaine des govtech ou bien du droit ?
U. B. : Je ne connaissais pas, personnellement, l’expression “right tech”, mais, du point de vue du courant Solarpunk, décrivant des avenirs souhaitables, proches de l’utopie, je l’analyserais volontiers comme une question de subsidiarité du recours à la technologie. Je m’explique : tout en rejetant le technosolutionnisme, nous savons que nous avons besoin, parfois en urgence, de la technologie, et qu’il serait, sans doute, déraisonnable et regrettable, d’en refuser, collectivement ou individuellement, le bénéfice, lorsqu’il s’agit, par exemple, de sauver des vies, ou de préserver des ressources qui, elles, permettront de le faire.
Donc, pour moi, “right tech”, pourrait s’analyser comme l’usage raisonnable et donc subsidiaire de la technologie (tout en continuant, bien sûr, à faire de la Recherche et du Développement pour l’améliorer) ; le principe de subsidiarité existe aussi en droit, mais il n’a pas le même sens.
Le droit doit toujours aider à la cohésion sociale et intervenir seulement si l’entente n’est pas possible dans les respects des lois déjà promulguées, mais il ne faudrait pas y recourir systématiquement en premier. Une sorte de “right law”, en somme, serait fondée sur la prudence et la sobriété du législateur. Le contraire, en somme, de la tendance actuelle, très américaine, à la judiciarisation de la société.
Vous avez affirmé pour Usbek et Rica : “Je préfère encore me risquer à la souveraineté directe que tout confier à l’IA”… En fin de compte, la technologie n’est-elle pas justement un reflet de nos biais collectifs ? Comment faire pour utiliser l’IA en tant qu’outil utile pour la démocratie ?
U. B. : Comme dit Jessica Bateman dans ses articles : « La technologie est créée par les humains. Elle est donc perméable aux préjugés et aux stéréotypes ». Et pour aller plus loin, on sait que le monde de l’économie numérique reproduit, et parfois aggrave, les biais genrés de la société, loin de résoudre les inégalités les plus flagrantes, notamment entre les hommes et les femmes. De nombreux groupes d’études, notamment celui de la professeure de droit privé Marina Teller, qui dirige le groupe de recherche sur le droit algorithmique, à l’Université Côte d’Azur, Deep Law for Tech, travaillent sur ces questions essentielles.
L’IA peut être un outil utile pour la démocratie à condition de s’assurer qu’elle soit capable de faire preuve d’impartialité. Il ne faudrait pas que, à cause de la fascination pour le progrès technique, la déesse Thémis ôte son traditionnel bandeau sur les yeux pour chausser, à sa place, un casque de réalité virtuelle qui l’empêcherait, en raison de biais de programmation, de voir la réalité de la société en face et de juger en toute connaissance de cause. Le risque est grand de trahir, par la technologie, la tradition libérale et égalitaire de notre idéal démocratique, forgé par l’Histoire. Une prudence – souvent indissociable de la réflexion du juriste, en tout cas depuis Rome – est plus que jamais de bon aloi.

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits