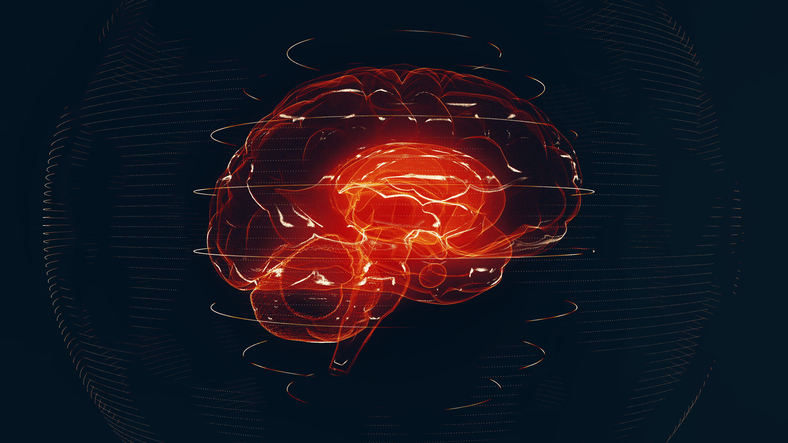Qui veut jouer les cobayes et se faire poser un implant cérébral connecté ? En septembre 2023, la start-up Neuralink d’Elon Musk annonçait qu’elle recherchait des volontaires pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. « Lève-toi et marche ! » aurait dit un jour Jésus à Lazar. Le milliardaire veut, peu ou prou, faire la même chose : en reliant le cerveau d’un patient paralysé à un ordinateur, il espère pouvoir lui rendre l’usage de ses jambes… Aux aveugles, il promet de rendre la vue, aux malades atteints d’Alzheimer, toutes leurs capacités cognitives et intellectuelles, et aux dépressifs leur joie de vivre. Quel pari fou ! Neuralink a été créée en 2016. Elle a attendu longtemps le feu vert de la FDA, l’administration américaine chargée d’autoriser ou d’interdire la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis, pour mener des essais non plus seulement sur les animaux, mais sur des humains. C’est désormais chose faite. La société peut à présent mener les premiers essais cliniques dans un hôpital sur des volontaires atteints de quadriplégie due à une lésion de la moelle épinière ou encore de la maladie de Charcot.
Terminé l’homme malade, diminué ou empêché
Terminé l’homme malade, diminué ou empêché : les nouvelles technologies seront capables de « réparer » l’homme blessé. En soi, c’est déjà le cas : les neurotechnologies sont de plus en plus utilisées pour soigner ou réparer les handicaps grâce aux avancées impressionnantes dans la connaissance du cerveau et de ses 100 milliards de neurones et, plus globalement, du fonctionnement du système nerveux. Ainsi certaines personnes handicapées peuvent désormais piloter leur fauteuil roulant par la pensée et des personnes amputées d’un membre peuvent ordonner à leur main robotique d’attraper un verre.À Lausanne, en Suisse, un jeune homme paraplégique a même pu retrouver, pour la première fois et après douze ans d’immobilité, un contrôle naturel de la marche par la pensée, grâce au couplage de deux technologies rétablissant une communication entre le cerveau et la moelle épinière. La start-up américano-australienne Synchron a développé un implant baptisé Stentrode qui évite de recourir à une chirurgie « à ciel ouvert » en permettant une insertion via un stent positionné dans une veine à l’arrière du cou. Une fois placé dans le cortex moteur, le dispositif se déploie pour placer ces électrodes sur les parois des vaisseaux sanguins où il peut capter les signaux neuronaux qui sont ensuite transmis à une unité de décodage externe qui va traduire ces signaux en actions, pour contrôler un bras robotisé par exemple. « Si le cerveau fonctionne, nous pouvons capter ses informations et les utiliser pour contrôler des fonctions que les patients auraient perdues, indique le fondateur de Synchron. L’objectif est qu’ils puissent retrouver un usage le plus normal possible de leur corps ».
Elon Musk n’est pas le seul à investir dans l’espoir d’être le premier à donner naissance à un surhomme, aussi appelé « l’humain+ », à savoir un homme dont le cerveau serait relié à un ordinateur et fusionnerait ainsi avec la machine. D’autres start-ups y travaillent aussi, à l’image de Synchron qui a levé en 2022 75 millions de dollars lors d’un tour de table incluant les fonds des milliardaires Jeff Bezos et Bill Gates. Aux États-Unis, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), l’agence de recherche du Pentagone, finance plusieurs organisations susceptibles de développer des implants cérébraux à coups de dizaines de millions de dollars. La start-up texane Paradromics, qui espère aider les personnes atteintes de troubles de la parole à communiquer, est l’une d’entre elles. Mais les investissements s’avèrent également massifs dans la recherche en vue d’applications non médicales.

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits