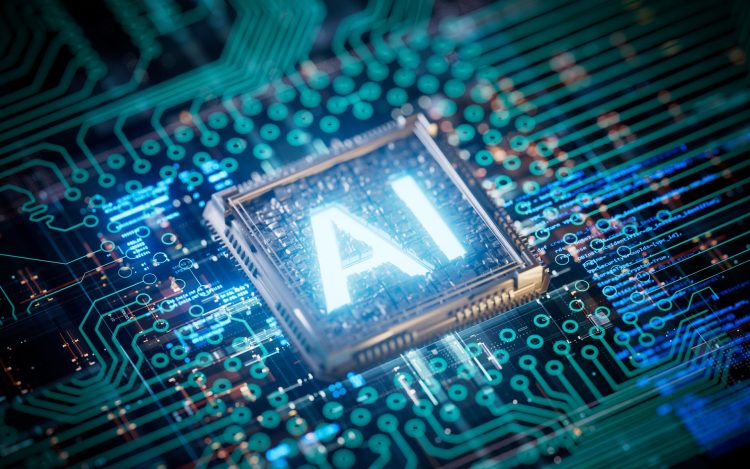Longtemps considérée comme un simple outil d’automatisation des tâches répétitives, la robotique est en passe de transformer en profondeur la recherche en laboratoire.
Une contribution de Fabrice Turlais, VP Responsable du service Chimiothèque d’Evotec France, intervenant lors de la dernière édition du salon Forum LABO (25-27 mars 2025, Paris Porte de Versailles)
Face aux grands défis de notre époque, notamment dans le domaine de la thérapie génique ou de la réduction des tests sur les animaux, la robotique – qui plus est lorsqu’elle est couplée à l’IA – s’impose comme un levier incontournable pour faire évoluer la science dans son ensemble. Mais cette révolution technologique se heurte encore à des freins majeurs, qu’il s’agisse de coûts, d’intégration ou de formation des chercheurs. Alors, comment la robotique va-t-elle concrètement transformer la recherche et quelles sont les clés pour accélérer son adoption ?
La robotique, un outil devenu clé pour la R&D
Depuis plusieurs décennies, l’automatisation et la robotique ont transformé de nombreux secteurs, et la recherche en laboratoire ne fait pas exception. Apparue dans les années 1980 avec l’objectif de remplacer les gestes humains répétitifs, la robotique de laboratoire a depuis évolué pour devenir un véritable levier d’innovation, ouvrant la voie à des avancées scientifiques majeures.
En effet, au fil des années, la robotique de laboratoire a permis de standardiser et d’accélérer un grand nombre de processus scientifiques. Ce fut d’abord le cas dans l’industrie pharmaceutique, où l’automatisation a rendu possible le criblage ultra-haut débit (UHTS), une technologie qui teste des millions de molécules en un temps record afin d’identifier des candidats-médicaments prometteurs. Grâce aux robots capables de manipuler des volumes de l’ordre du nanolitre – soit bien plus petits qu’une simple goutte d’eau – la recherche de nouvelles thérapies est désormais plus rapide, plus fiable et plus efficace.
L’automatisation révolutionne également la recherche sur les thérapies cellulaires et géniques. L’un des enjeux actuels est de mieux comprendre les maladies à l’échelle cellulaire en utilisant des modèles in vitro avancés, réduisant ainsi la dépendance aux tests sur animaux. Grâce à des plateformes robotiques de plus en plus sophistiquées, les chercheurs peuvent manipuler des lignées cellulaires complexes et tester l’efficacité de nouvelles thérapies sur des échantillons de patients avec une précision inégalée. Par exemple, au lieu d’attendre des années pour observer les effets d’un traitement sur des cohortes de patients, il devient possible de simuler ces effets en laboratoire sur des cellules humaines.
IA & robotique : un duo gagnant en faveur de la recherche
Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, les avancées en intelligence artificielle ouvrent la porte à une nouvelle génération de robots plus flexibles et plus intuitifs. Là où les plateformes robotiques traditionnelles étaient limitées par des protocoles rigides, l’IA permet d’adapter en temps réel les manipulations et d’intégrer des systèmes de prise de décision automatisés. De plus, l’intégration de l’IA dans ces systèmes robotiques permettra de mieux analyser les données issues des expérimentations et d’accélérer le passage des découvertes fondamentales aux essais cliniques.
La robotique, associée à l’IA, ouvre donc un nouveau chapitre dans la recherche scientifique. Plus rapide, plus précise et plus flexible, elle promet d’accélérer la découverte de traitements innovants et de transformer durablement la façon dont nous abordons la médecine de demain… à condition que son accélération ne soit pas entravée.
Des défis à relever pour une adoption massive et rapide
Malgré ces avancées, plusieurs freins persistent à la généralisation de la robotique en laboratoire. L’un des principaux obstacles reste le coût d’acquisition et de maintenance de ces technologies, en particulier pour les institutions de recherche publique qui peinent à investir dans des plateformes automatisées. L’intégration de ces outils dans les infrastructures existantes représente également un défi, notamment en raison de la compatibilité des systèmes informatiques et des exigences de cybersécurité. Par ailleurs, la formation des chercheurs à ces nouvelles technologies est essentielle. Aujourd’hui encore, la programmation et l’utilisation des robots nécessitent des compétences spécifiques, limitant leur adoption par des scientifiques non spécialisés. L’IA pourrait toutefois contribuer à lever cette barrière en rendant les plateformes robotiques plus intuitives et plus autonomes. Enfin, le développement de partenariats entre le secteur public et privé est crucial pour favoriser l’innovation et l’adéquation des technologies avec les besoins réels des laboratoires.
Alors que les attentes en matière de santé et de progrès scientifiques sont immenses, la robotique de laboratoire apparaît comme une solution incontournable pour répondre aux défis du XXIe siècle. Chercheurs, fournisseurs, industriels… il est crucial de renforcer les échanges pour accélérer la mise en place de solutions robotiques adaptées aux défis de la recherche moderne !
À lire également : IA médicale : sans cadre de remboursement, pas de révolution

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits