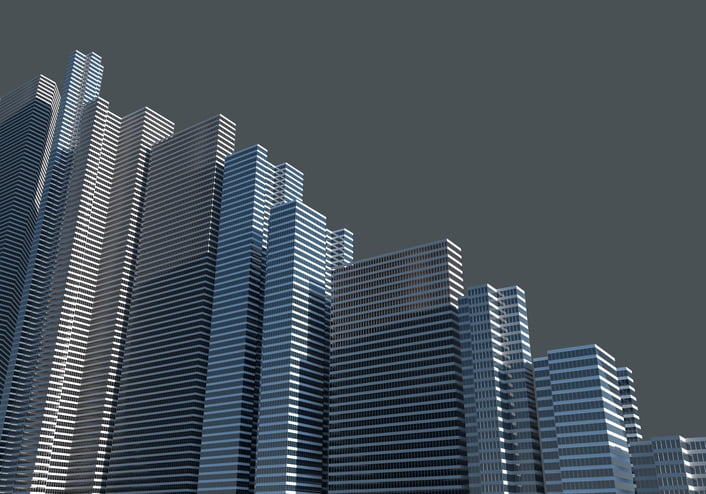La crise du coronavirus montre, d’une part, les interdépendances des différents écosystèmes à l’intérieur d’un pays (santé, économie, éducation, social, …) et d’autre part, les interdépendances entre les pays (interdépendances économiques, technologiques, sanitaire…). Dans ce salmigondis d’interdépendances et d’interférences, nonobstant le secteur de la santé entièrement mobilisé pour résoudre la crise sur le plan sanitaire, les efforts des pouvoirs publics se sont focalisés sur les entreprises. Ces dernières, piliers de l’économie ne doivent pas s’effondrer. Les nations qui le peuvent ont mobilisé tous les moyens possibles pour les sauvegarder. En France, le chômage technique a été massivement utilisé « quoi qu’il en coûte » selon l’expression consacrée par le Président Emmanuel Macron.
Le coût est bien sûr exorbitant pour la communauté nationale mais les conséquences d’un effondrement de l’économie peuvent être désastreuses pour la génération actuelle et peut-être pour la suivante. L’histoire n’est pas encore écrite car la crise est loin d’avoir été résorbée. Nous jugerons après coup de l’efficacité de telles mesures. Néanmoins, ce qui a été donné à voir par l’expression « quoi qu’il en coûte » est fondamental. C’est la consécration qu’une entreprise n’est pas juste un lieu de création de valeur capitalistique mais une des institutions clés de la société.
Milton Friedman nous avait fait oublier la centralité de l’entreprise comme institution avec sa déclaration martiale dans les années 1970 : « l’unique responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits » ; il mettait ainsi des mots sur les maux du règne du capitalisme financier.
Les crises successives récentes (crise des subprimes, crise du Coronavirus) mettent en exergue les liens indissociables entre la société et les entreprises. Bien sûr, ces dernières sont la pierre angulaire de l’économie moderne mais la société par l’intermédiaire de l’état joue son rôle « d’assureur » en temps de crise comme nous le voyons actuellement mais aussi son rôle de fournisseur, en temps de paix, de capacités indispensables pour le développement des entreprises (infrastructures, santé, législation etc…).
La coopération entre l’état et les entreprises pour sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation lors d’une crise comme celle en cours ne saurait cacher la divergence de leurs intérêts, divergence qui n’est pas une fatalité mais la résultante d’un construit économique et d’une philosophie gestionnaire assumée.
En effet, le modèle d’efficacité absolue c’est-à-dire la recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace, moteur du développement technologique et capitalistique des entreprises ne s’enquiquine d’aucune morale de l’action, ni le bien, ni le mal, ni le bon, ni le juste, ni le beau. Ce qui compte, c’est ce qui est efficace, techniquement faisable, confirmant ainsi la loi de Gabor.
Dès lors, cette quête d’efficacité sans borne, érigée en modèle absolu ne saurait croître sans se retourner contre les intérêts de la société : transferts de coûts sociaux à la collectivité par des licenciements dont la seule justification est boursicotière, concurrence avec l’état notamment sur des sujets essentiels à la vie d’une nation (sécurité, social…), augmentation exponentielle des inégalités de revenus occasionnant des tensions sociales, prise en compte insincère des enjeux environnementaux (greenwashing) mettant en péril l’écoumène et les équilibres sociaux-économiques…
Cette divergence des intérêts a largement été analysée et commentée car elle n’est pas soutenable. D’ailleurs les pouvoirs publics proposent des pistes de règlement : on peut citer la responsabilité sociale des entreprises (RSE), la possibilité donnée aux entreprises de formaliser leur raison d’être ou encore de choisir le statut d’entreprise à mission etc. Ces initiatives ne traitent hélas que des signes mais pas des causes intrinsèques de ces divergences d’intérêts. Le modèle de l’entreprise « sans feu ni lieu » ancré dans une conception utilitariste du monde dont l’objectif n’est pas « d’aider les hommes à mieux vivre » perdure.
L’enjeu véritable consiste à faire jouer pleinement à l’entreprise son rôle institutionnel c’est-à-dire « politique » dans le sens premier du terme, celui qui l’enjoint à se situer et à agir dans un contexte économique, social, sociétal et environnemental afin de « ne pas perdre le sens des ensembles ». L’entreprise comme institution requiert de passer d’une gestion de l’entreprise comme technique de pouvoir du propriétaire (Jean-Claude Liaudet) avec l’injonction de ne décider qu’en fonction des intérêts de ce dernier à une gestion politique, une gestion située qui laisse aux communs et à l’incalculable une juste place. Il s’agit de « reconnaître à l’entreprise qu’elle a le pouvoir d’organiser nos vies. C’est donc à la fois la contraindre à assumer ce pouvoir (à se conduire correctement, sans fuir ses responsabilités) et à le limiter (l’encadrer, le faire entrer dans le domaine du droit commun, éviter les abus et le zèle missionnaire) » (Richard Robert).
Instituer ce rôle politique requiert la déconstruction du sophisme économiciste, tâche à laquelle se sont attelés des économistes comme Karl Polanyi mais aussi de reformer un système éducatif reposant quasi exclusivement sur l’approche par les compétences, philosophie éducative du paradigme gestionnaire dominant. La compétence est bien sûr importante car elle atteste “la capacité à résoudre un problème dans un contexte donné”. Ce qui est en cause, c’est un système éducatif qui en fait l’alpha et l’oméga de sa pédagogie.
La compétence est définie par Olivier Reboul qui a activement contribué à la philosophie de l’éducation comme étant « la possibilité, dans le respect des règles d’un code, de produire librement un nombre indéfini de performances imprévisibles, mais cohérentes entre elles et adaptées à la situation ». L’exégèse d’une telle définition met en exergue plusieurs choses : l’expression d’une compétence doit être assujettie au respect des règles d’un code ; exercer une compétence, c’est produire des performances certes imprévisibles mais cohérentes entre elles ; enfin, ces performances doivent être adaptées à la situation. Dans une philosophie gestionnaire utilitariste et technicienne (recherche en toute chose de la méthode absolument la plus efficace), la compétence n’est rien d’autre que le potentiel pour satisfaire une tâche donnée dans le respect des instructions. Ainsi, la compétence est un artefact qui continue une certaine logique taylorienne par d’autres moyens. Elle sous-tend une rationalisation de la subjectivité (Joyce Durand-Sebag). L’expression d’une compétence ne requiert ainsi aucune capacité de bifurcation mais seulement une capacité d’adaptation. En effet, penser, c’est bifurquer (Bernard Stiegler). Pour penser, il faut être capable d’avoir du discernement, de « critiquer » la tâche, c’est-à-dire ne pas s’y adapter mais la dépasser en la mettant en perspective dans un environnement situé (économique, politique, social) mais aussi selon des visées axiologiques et éthiques.
Nous comprenons donc aisément pourquoi, en dépit des crises successives et malgré les velléités de réforme des enseignements dans les universités et les grandes écoles, rappelons-nous du boycott du cours de l’économiste Gregory Mankiw, professeur à Harvard par 70 étudiants qui arguaient que son cours « Economics 10» relayait l’idéologie accusée d’être à l’origine des déséquilibres économiques ayant entraîné la crise des subprimes, rien ne change dans les faits.
Le modèle de la compétence armé de sa technologie de l’esprit, le « problem solving », n’a pas été remis en question malgré les discours humanistes et sociétalistes post-crises. Ces reformes se limitent souvent à des cours d’éthique ou de développement durable sans questionner la cause racine, la force conformatrice que représente la compétence dans une perspective « d’employabilité », cet appel à bas bruit à s’adapter pour toujours plus d’efficacité en faisant fi de finalités autres qu’économiques.
Le rôle politique des entreprises ne pourra pas être assuré par des individus formés au commerce de de la pensée toute faite c’est-à-dire des hommes et des femmes strictement adaptés à leurs tâches. Un tel sacerdoce incombe aux « voyous de la pensée » (Gilles Chatelet) capables d’appréhender le sujet, la scène c’est-à-dire le contexte, le sens et le sacré des communs. En effet, ce rôle politique a pour finalité ultime la production et la promotion de pratiques et d’innovations (managériales, techniques, technologiques) explicitement orientées dans l’espace et dans le temps pour, a minima, préserver les communs et la dignité des sujets. Il s’agit de rompre avec les fameuses « bonnes » pratiques qui ne sont bonnes que pour prescrire implicitement une certaine réalité sensée être indépassable en gommant au passage, le sujet, les spécificités des lieux, des temps et des moments.
Il va sans dire que les situations que la génération actuelle et les suivantes ont à faire face ne requièrent pas de solutions. Une solution est une réponse à un problème. Un problème comme aimait à le définir Gabriel Marcel, est quelque chose qui barre la route, c’est-à-dire qu’il est tout entier devant soi. Les enjeux sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux actuels interrogent l’être, son devenir et son rapport au monde. Ce ne sont donc pas des problèmes. La pratique intempestive du « problem solving » et plus généralement l’approche exclusive par les compétences, au mieux, euphémisent et donc radicalisent un réel déjà inflammable.
La véritable éducation doit être tournée vers la formulation de problèmes et la critique de la compétence. Il ne s’agit bien sûr pas de revenir à la paideia des grecques, cette formation hétéroclite intraduisible par un seul concept comme le précise Werner Jaeger : « civilisation, tradition, littérature ou éducation. (…) En les prenant toutes ensemble, on ne saurait les employer pour exprimer le sens complet du mot grec ». Une telle philosophie éducative serait aujourd’hui, hélas, anachronique car non adaptée aux rythmes de la vie moderne.
Il s’agit simplement de rompre avec l’approche exclusive par les compétences, souvent saupoudrée de « cross fertilisation » des « savoirs », cet ersatz moderne de la culture. L’éducation ne peut pas avoir comme but ultime de mettre sur le « marché » des producteurs et des consommateurs. Une telle éducation n’est rien d’autre qu’une idéologie en action car l’homme ainsi résumé à ses compétences est un homme sans qualité ou juste des qualités (techniques) sans homme c’est-à-dire un homme désaffecté. Dans une telle perspective, comment s’étonner que le producteur/consommateur soit en conflit ouvert avec le citoyen, la schizophrénie du désir aidant ?
Pallier les divergences entre la société et les entreprises nécessite de traiter à la racine cette schizophrénie du désir qui fait que nous sommes les concepteurs, bien souvent au sein des entreprises, de ce que nous rejetons comme citoyens, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes », disait Bossuet.
Une réponse éducative pertinente doit s’appuyer sur une véritable « diplomatie des disciplines » qui permet de penser les conditions de possibilité de toute action et les conditions de validité de ses hypothèses dans une perspective politique et de responsabilité pour autrui. Cela consiste à corriger et à dépasser cette « culture de commerçants » dont parlait Nietzsche et pour laquelle la « question des questions », c’est de savoir « quelles personnes et combien de personnes consomment cela ? ». Cette culture de commerçants a fini par forger notre représentation du monde, par façonner notre raisonnement et notre intelligence, par modeler nos connaissances et nos créations.
Ce travail de décolonisation de ce qui est devenu le sens commun incombe à tout un chacun mais surtout aux producteurs « professionnels » de savoirs (l’académie, les prestataires de services intellectuels…) dans un contexte où une révolution numérique mal digérée, au lieu de fertiliser la faculté de penser de l’homme tend à prolétariser ce dernier comme jamais il ne l’a été.
Nous pouvons donc faire nôtre la dernière phrase de Freud dans sa correspondance avec Albert Einstein à propos de l’inclinaison de l’homme pour la guerre : « …nous pouvons nous dire : tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre ». En l’espèce, nous pouvons dire que tout ce qui travaille au développement de la culture, la véritable, c’est-à-dire la capacité à relier les savoirs (à ne pas confondre avec la documentation), travaille aussi pour la convergence des intérêts entre les entreprises et la société.
<<< A lire également : Le Digital Nomade Va-Il S’imposer En Entreprise ?>>>

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits