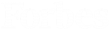Marianne Rosenberg, issue d’une grande lignée de marchands d’art spoliée par les nazis, continue de faire briller son nom dans l’univers scintillant des Galeristes qui comptent. Elle présentera des œuvres représentatives de ses choix audacieux lors du salon Fab Paris, l’une des foires des arts décoratifs les plus importantes au monde, qui aura lieu du 22 au 26 novembre au grand palais éphémère.
Quand on est la petite-fille de Paul Rosenberg, l’un des plus grands marchands d’art du XXe siècle, on devient forcément galeriste ?
Marianne Rosenberg : Mon histoire fut un peu plus compliquée que cela. Il est vrai que j’ai grandi dans cette atmosphère particulière, marquée par le négoce d’œuvres d’art, mais aussi par les spoliations dont a été victime ma famille puis les restitutions. Pendant les vacances, j’allais plus souvent au musée qu’à la plage. Le Prado, le Louvre, les monuments historiques, les églises, j’ai multiplié les visites durant toute mon enfance.

Puis vint le temps des études. Vous avez approfondi votre connaissance des arts à l’université ?
M.R. : J’obtiens mon bac dans les années 70 au lycée français de New York. Comme je suis passionnée par la littérature, la philosophie et le latin, je fais hypokhâgne/khâgne avant de partir en France pour rejoindre Sciences Po. Je suis aussi un cursus de droit à Paris II. À l’âge de 22 ans, j’ai une première expérience dans un cabinet d’avocats parisien puis je retourne à New York pour passer ma maîtrise. Mon diplôme en poche, j’entre chez White & Case, un cabinet d’avocats international américain. Je deviens dans les années 80 l’une des rares femmes à évoluer dans le secteur de la finance mondiale. Je suis très douée, on me confie des dossiers compliqués et des clients importants comme la SNCF. Je suis avocate au barreau de New York.

Quand et comment avez-vous pris un virage vers l’art ?
M.R. : Je me suis mariée et j’ai eu deux enfants. À la suite de la crise de 2008, mon métier a commencé à se désagréger. Je voulais consacrer plus de temps à ma famille. J’ai commencé à me poser des questions. Je décide de lâcher le droit et d’ouvrir ma galerie dans les années 2010. J’ai voulu me relier à mon histoire. À la mort de Paul, mon père Alexandre a créé aux États-Unis l’association des marchands de tableaux américains. Mais à la différence de Paul, il ne souhaitait pas de successeur. Mon père n’était pas comme son père, marchand à 100 %. Il étudiait la philo, le talmud… Il aimait la vie intellectuelle. Il est mort jeune, à 66 ans. Sa galerie a été fermée dès 1987, l’espace a été loué.
Qui des restitutions des œuvres qui vous ont été volées pendant la Seconde Guerre mondiale ?
M.R. : C’est ma mère et moi qui nous nous en sommes chargées. On en a récupéré un peu moins de 400 sur les 450 spoliées. C’est un travail de longue haleine, il faut suivre toutes les ventes, à Paris, Libourne, ou même à Floirac. Il y avait des Van Gogh, Corot, Picasso, Matisse… Heureusement, mon grand-père avait tenu un inventaire précis, ce qui nous a aidées à monter des dossiers solides.


Avez-vous réussi à vous reconnecter avec votre histoire ?
M.R. : Je pense, oui. Le nom de Rosenberg est revenu au premier plan dans le monde de l’art. Je pense posséder de bonnes connaissances techniques et, surtout, un œil qui me permettent de bien acheter. J’essaye de jeter des ponts entre les États-Unis et la France, notamment en popularisant les artistes français et européens auprès du public américain. Et quand je viens en Europe, j’essaye de faire connaitre les artistes américains



Quelles sont les spécificités de votre galerie ?
M.R. : J’ai voulu créer un lieu où il n’y a pas que des expos et des vernissages. J’organise aussi des conférences, des projections de films, toutes sortes d’événements qui font vivre la galerie.
Et au niveau artistique ? Vous suivez une « ligne éditoriale » ?
M.R. : Sans doute mais elle n’est pas facile à définir. L’œil est un instrument subjectif. J’essaye de porter mes choix sur des œuvres qui ont joué un rôle dans l’histoire de l’art et qui restent accessibles sur les plans artistique et financier. Concernant les techniques, je vends des tableaux, des sculptures, des collages. De temps en temps, il m’arrive de proposer des choses plus hermétiques, c’est alors le rôle du galeriste d’expliquer comment elles s’inscrivent dans un continuum.
Vous n’êtes pas attirée par la photo ?
M.R. : Je ne suis pas intéressée par les multiples, je connais mal ce marché. Il y a des spécialistes qui font cela très bien. Mais je défends, par exemple, le militant Fred Stein. Dans les années 30, il distribuait des tracts anti-nazis en Allemagne. Puis il a fui à Paris où il a commencé la photographie. Il a notamment immortalisé des scènes liées au Front populaire. Il s’est ensuite exilé aux États-Unis. En général, il n’existe qu’un seul tirage de ses photos. Ce sont des pièces uniques.

Y a-t-il un « esprit Rosenberg » qui guide votre travail ?
M.R. : Oui, d’une certaine manière. Tout d’abord, j’ai un respect absolu pour Paul qui était le galeriste visionnaire par excellence. J’essaye, comme lui, de défendre des œuvres de qualité qui s’inscrivent dans l’histoire de la galerie, donc datant des années 20 aux années 50. Comme mes ascendants, j’ai une intégrité morale absolue. Je rejette systématiquement tout ce qui me paraît douteux. Comme mon père Alexandre, je pratique ce métier avec passion, même si je ne possède pas ses connaissances encyclopédiques.
New York reste-t-elle la place la plus importante du marché de l’art dans le monde ?
M.R. : Oui, je pense. Intérieurs de la galerie Rosenberg & Co de New York
Vous arrive-t-il de révéler des artistes contemporains ?
M.R. : Oui, parfois, même si je le répète, ce n’est pas mon credo. Je représente par exemple Aude Herlédan qui est une artiste française dont le style évoque l’abstraction des années 50 et quelque chose de plus contemporain au niveau des matières.
Pensez-vous que le street art soit la révolution artistique du troisième millénaire ?
M.R. : Ma curiosité intellectuelle est insatiable. Mais si je regarde tout, ça ne veut pas dire que j’aime tout ou que je comprends tout. Le street art est à mes yeux une forme d’expression spontanée intéressante. Mais je ne connais pas assez pour répondre de façon tranchée à votre question.
<<< À lire également : La Cornue : Tout Feu Tout Flamme Avec Son Fourneau « Château » Street Art >>>

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits