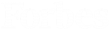La crise sanitaire a plongé la majorité des pays en récession cette année. En effet, la France devrait connaître une contraction du PIB de 9,8% et l’Espagne de 12% cette année. Cette récession devrait s’accompagner d’un fort rebond en 2021. Ces variations apparaissent colossales et traduisent la singularité de cette crise : un choc d’offre et de demande concomitant. De fait, en raison de la multiplication des crises, faudrait-il repenser la manière de comptabiliser la richesse produite ?
Le produit intérieur brut (PIB) mesure la création de richesse d’un pays sur une période donnée, c’est un flux. Il comptabilise l’ensemble de la valeur ajoutée créée à l’échelle nationale. On entend par valeur ajoutée la valeur marchande de la production déduite des consommations intermédiaires. L’indicateur du PIB est accepté de façon conventionnelle comme indicateur mesurant la croissance économique, il n’a pas pour finalité d’évaluer le bien-être de la population ou encore le niveau de développement d’un pays. De fait, cette approche comptable présente quelques limites.
D’abord, les services non marchands, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas vocation à être vendus sur un marché sont intégrés au PIB en supposant que leur valeur est égale à leur coût de production alors que la création de richesse effective est bien plus importante. Ainsi, les services publics ne génèrent pas de valeur monétaire. Pourtant, les services liés à l’éducation, la santé, la sécurité apparaissent essentiels pour appréhender le niveau de développement d’une société et ont un fort impact économique. La crise actuelle nous le rappelle car les mesures de confinement sont, en partie, corrélées à la capacité des hôpitaux.
De plus, la production d’un bien ou d’un service génère des externalités non traduites dans le prix. L’exemple commun d’une externalité négative est celui de la pollution : une industrie polluante génère de la valeur ajoutée intégrée dans le PIB mais a un impact néfaste sur l’environnement. Au contraire, la diffusion de la connaissances grâce au numérique telle que l’open source est une externalité positive . Pour prendre en compte ces externalités dans un calcul comptable, il faudrait être en mesure de pouvoir « internaliser » ces externalités. Pour autant, il est difficile d’apprécier le coût d’une externalité et d’avoir une évaluation fine des coûts ou bénéfices. Ainsi, la puissance publique a souvent recours à la fiscalité afin de créer des incitations chez les agents économiques (Théorème de Coase, 1960).
De manière plus générale, la prise en compte des externalités liées à l’environnement et au numérique apparaît centrale et est pourtant peu reflétée dans l’élaboration du PIB.
Saisir la dimension environnementale impliquerait de comptabiliser un stock de ressources naturelles pour pouvoir le déprécier ou non au cours du temps, c’est ce qu’initie la notion de « capital naturel » (Schumacher, 1973).
La non prise en compte de ces externalités a un impact négatif sur l’économie. Dans le secteur financier par exemple, on parle déjà « d’actifs échoués » dans les bilans bancaires pour désigner la perte de valeur des actifs polluants lors de la transition énergétique avec la mise en place de modèles bas-carbone.
L’économie numérique, quant à elle, échappe pour une bonne partie à la comptabilité nationale parce qu’elle est le fruit d’une chaine de valeur dématérialisée et difficilement localisable physiquement. La productivité accrue qu’elle permet est rarement mesurée si bien qu’elle a donné naissance au paradoxe de Solow (1987) : « l’informatique serait partout, sauf dans les statistiques de la productivité ». L’économie numérique ne compte que pour 4,3% du PIB en France selon Eurostat alors que des nouveaux réseaux de partage ou encore la baisse du coût de l’information s’observent grâce à la digitalisation. Le commerce des données numériques et l’économie de partage se caractérisent par une affectation physique, spatiale et temporelle très floue. Les sociétés de services tendent de manière générale à une création de valeur qui n’est plus localisée physiquement et rend complexe son intégration au PIB.
Enfin, le PIB est un agrégat national qui ne prend pas en compte les disparités entre les habitants. On peut certes calculer le PIB par habitant mais il ne donne pas d’informations sur la répartition des richesses au sein d’un pays puisqu’il la suppose homogène. Les inégalités sont donc absentes de l’indicateur qui restitue, au mieux, la part des revenus du capital sur l’ensemble des revenus. Il faudrait alors prendre en compte la distribution des revenus au sein des comptes nationaux, tels que les « comptes nationaux distributifs » (DINA) créés par Bertrand Garbinti, Jonathan Goupille-Lebret et Thomas Piketty (2018) ou encore le coefficient de Gini qui rend compte de l’inégalité dans la répartition des revenus d’une population
Ces réflexions et impasses ont nourri de nombreux travaux sur des indicateurs qui viendraient compléter ou remplacer le PIB en faisant apparaître des notions qui se réfèrent au développement et au bien-être. En combinant différents indicateurs quantifiables comme par exemple la dette, la scolarisation, la part des énergies renouvelables, la qualité des infrastructures, l’insertion des jeunes ou encore la reproduction des inégalités ; les organisations internationales, les instituts de recherche ou même certains pays publient aujourd’hui des indicateurs alternatifs. C’est le cas depuis 1990 avec l’Indicateur de développement humain (IDH) de l’ONU, le Better Life Index de l’OCDE depuis 2011, l’Indice de santé sociale (ISS) du Fordham Institute for Innovation in Social Policy depuis 1980 ou encore l’indicateur de progrès véritable (IPV) de la fondation californienne Redefining Progress depuis 1994 et le produit intérieur doux créé en 1999 par le Carrefour des savoirs sur les finances publiques au Québec.
Tous ces indicateurs ont en commun de vouloir repenser la façon dont on crée de la valeur collective au sein de la société. Sans doute que la notion de valeur elle-même pourrait être repensée si l’on s’intéresse à la façon dont elle a été construite et les fondamentaux économiques néoclassiques sur lesquels elle repose. Adam Smith souligne dans son ouvrage la Richesse des Nations (1776) les deux significations du mot valeur : la valeur d’usage (l’utilité d’un objet particulier) et la valeur d’échange (faculté que donne la possession de cet objet d’acheter d’autres marchandises). Aujourd’hui, la valeur d’échange domine à travers la notion de prix mais on omet de fait de conjuguer cette valeur d’échange avec la valeur d’usage qui viserait à mieux prendre en compte l’utilité individuelle et sociétale de ce que nous créons car rappelons-le, la finalité de l’économie reste le bien-être commun.
Article rédigé par Anne-Sophie Alsif, BSI Economics
<<< A lire également : USA : PIB En Baisse Et Taux De Chômage En Forte Hausse Pour Goldman Sachs >>>

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits