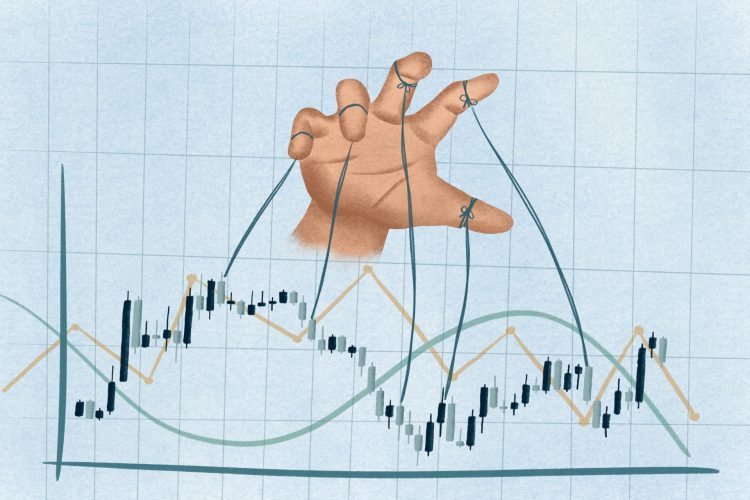Les organismes de prévision continuent de confirmer une trajectoire très favorable de la croissance mondiale pour cette année, et même pour 2019. Dans le même temps, les marchés financiers n’affichent plus la même décontraction depuis quelques semaines. L’agitation qui y règne suggère une plus grande fébrilité de la part des investisseurs. Qui faut-il donc croire ?
C’est à chaque fois la même histoire ou presque : quand les organismes économiques internationaux nous disent que ça va mal ou prédisent que demain sera encore pire qu’aujourd’hui, on stigmatise leur pessimisme. Lorsqu’ils ont, au contraire, « le malheur » de nous faire miroiter l’été, alors qu’on quitte à peine l’hiver, on recherche fébrilement, à la fin de leurs rapports, les raisons qu’on aurait malgré tout de voir arriver prématurément l’automne…
L’année 2018 n’échappera pas à ces raisonnements suspicieux et cycliques. Les dernières prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) suggérant une croissance mondiale très élevée (+3,9%) et susceptible de se maintenir l’an prochain (+3,7%) laissent ainsi un peu rêveur.
Non que l’analyse qui les sous-tende apparaisse biaisée. Après tout, les baisses d’impôts et la hausse de la dépense publique aux Etats-Unis, plus encore que l’assouplissement fiscal en Allemagne, sont bien de nature à dégager un supplément significatif de croissance.
Mais parce les marchés mondiaux, depuis plusieurs semaines et tout spécialement depuis mars dernier, offrent le spectacle d’étourdissantes turbulences, préoccupantes pour l’avenir.
Quand la guerre froide s’immisce dans l’économie
Il y a d’abord le pétrole, qui fait de nouveau parler de lui : vendredi 23 mars, le baril de brent (référence européenne) avait de nouveau franchi la barre des 70 dollars, seuil qu’il avait déjà atteint en janvier, soit son plus haut niveau depuis décembre 2014.
Un pic dont il est bien difficile d’ailleurs de savoir, à ce stade, s’il pourrait cacher d’autres embrasements possibles des cours, à la faveur des regains actuels de tension entre les Etats-Unis et l’Iran (qui pompe chaque jour plus de 3,8 millions de barils) ou encore de la vulnérabilité des installations pétrolières saoudiennes, sous la menace des tirs de missiles des rebelles yéménites…
Toujours est-il que les incertitudes géopolitiques deviennent un facteur déterminant de l’économie mondiale en 2018, tout spécialement dans ce nouveau climat de « guerre froide » voyant désormais s’affronter, sur fond d’affaire d’empoisonnement sur le sol britannique, le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux, à la Russie de Vladimir Poutine.
Une fumée noire commence ainsi à rendre l’atmosphère des relations économiques internationales particulièrement irrespirable, d’autant qu’elle s’épaissit encore au fur et à mesure des déclarations à l’emporte-pièce d’un Donald Trump, qui semble s’en donner plus que jamais à cœur joie, avec dans le collimateur la Chine et ses 375 milliards de dollars d’excédents commerciaux avec les Etats-Unis.
Dans de telles conditions, rien d’étonnant à voir les Bourses mondiales commencer à décrocher. La première correction intervenue en février en cachait une autre plus conséquente : la semaine du 19 au 23 mars a été marquée par un décrochage convergent aux Etats-Unis (recul de -6% du S&P 500), en Asie (-4,9% pour Tokyo) et, dans une moindre mesure, en Europe (-3,05% pour le STOXX Europe 600).
Feu de paille ou incendie boursier ?
Cet échauffement sera-t-il seulement un feu de paille ou la première étape d’un incendie bien plus ravageur pour les principales économies de la planète ?
Le second scénario est moins fantaisiste qu’on pourrait l’imaginer.
La menace la plus sérieuse sur la prospérité mondiale cette année, c’est sans doute le concours de « muscles » auxquels s’adonnent pour l’instant les deux géants économiques mondiaux, avec la déclaration de guerre commerciale du président américain à l’encontre de son homologue chinois, Xi Jinping, pour le moment impassible et inflexible face à la menace des quelque 50 milliards de dollars de sanction brandie par Washington. Mais le flegme chinois peut-il durer bien longtemps encore ? Et une escalade protectionniste, potentiellement si préjudiciable au commerce mondial, pourra-t-elle être évitée ?
Le danger pour la bonne santé des marchés, déjà ébranlés, et de l’économie mondiale tout entière viendrait d’un cumul d’infortunes : une exaspération des atteintes au libre-échange, doublée d’une remontée des taux d’intérêt, à la fois plus brutale et plus importante dans son ampleur que ce qui est pour l’instant prévu.
Un scénario dépressif qu’on ne peut hélas exclure. Car on s’attend à ce que la Réserve Fédérale américaine, désormais sous la conduite de Jerome Powell, relève plus fortement ses taux à l’avenir. Un mouvement qui pourrait aussi s’enclencher de ce côté de l’Atlantique, avec le virage monétaire pris par la Banque Centrale Européenne (BCE) le 26 octobre dernier, et la décision de Mario Draghi de mettre fin à ses achats massifs de titres dès cette année…
Le spectre d’un durcissement monétaire après des années où les liquidités ont coulé presque à flot n’est pas la seule épée de Damoclès sur la tête des économies américaine et européenne.
Donald Trump a montré qu’il n’avait guère de respect pour l’orthodoxie budgétaire. Sa politique de baisse massive des prélèvements obligatoires va encore davantage laisser filer la dépense et, avec elle, les déficits.
Des précautions à prendre dans la zone euro
La zone euro, pour l’heure relativement épargnée par le début de retournement des marchés, doit aussi régler ses propres problèmes d’endettement public si elle veut éviter l’implosion.
Aucune échéance électorale de la période 2017-2018 (Pays-Bas, France, Allemagne, Italie…) n’est arrivée à rompre le vent d’optimisme qui souffle depuis l’élection d’Emmanuel Macron l’an dernier, pas même la crise catalane ou encore les difficultés à former un nouveau gouvernement allemand autour d’Angela Merkel.
Les agences de notation, pourtant promptes à « dégrader », comme elles l’ont fait massivement entre 2009 et 2014 (en tout pas moins de 32 dégradations de notes d’Etats européens sur cette période), envoient de nouveau des signaux de confiance retrouvée, comme celui en direction du Portugal, enfin sorti des catégories de notations hautement spéculatives.
Se réjouir trop vite de cette « normalisation », qui touche aussi la France – de nouveau en dessous de la barre des 3% annuels de déficit public depuis l’an dernier- reste bien prématuré.
Notre pays, pour ne parler que de lui, est d’ailleurs encore très loin d’avoir sorti la tête de l’eau empoisonnée de l’endettement, puisque malgré une croissance plus solide et faute d’avoir su utiliser cette « cagnotte » pour se désendetter, affiche encore un ratio de dette sur PIB (97% en 2017) supérieur à celui de l’année antérieure…
Mais ce n’est pas la France, qui pourrait bien sortir en mai prochain de la procédure communautaire pour « déficit excessif », dans laquelle elle est empêtrée depuis 2009, qui inquiète les marchés. Les investisseurs ont les yeux rivés sur l’Italie, que ses incertitudes politiques rendent encore plus exposée sur le plan économique et financier à un possible retournement de cycle.
Les responsables de la zone euro n’ont donc pas d’autre choix que d’agir vite et bien s’ils veulent prévenir le risque de voir de nouveau les trajectoires de leurs membres diverger sur les marchés.
Plus facile à dire qu’à faire, d’autant que Paris et Berlin continuent de s’opposer fermement à tout mécanisme de type « euro-obligations », qui aurait pour effet de mutualiser au sein de l’UE le fardeau des dettes accumulées au cours des dernières décennies…
Des solutions existent malgré tout pour empêcher que les plus vertueux payent pour ceux qui l’ont été le moins.
Une note récente de l’Institut Friedland plaide ainsi en faveur de la création d’un nouveau type d’obligation d’Etat qu’on appelle « junior ». Par opposition à la dette « sénior » actuelle, offrant de sérieuses garanties, la première, moins protectrice, obligerait les créanciers à faire une analyse de risque plus approfondie des obligations souveraines qu’ils prévoient d’acheter.
Pour ces titres plus risqués (qui pourraient représenter jusqu’à 40% des obligations émises par les Etats), les investisseurs demanderaient naturellement une rémunération plus importante. Un bon moyen en somme d’inciter les Etats les plus concernés à restructurer leur dette…
On l’avait presque oublié avec l’euphorie conjoncturelle que nos économies traversent depuis quelques mois : la croissance mondiale n’est jamais acquise. Elle se conquiert chaque jour, à la force du poignet des dirigeants politiques de la planète, et de leur préférence pour le libre-échange et la coopération. Elle est aussi tributaire de la volonté des acteurs économiques, dont les capacités d’innovation restent évidement une clé de la prospérité commerciale de demain, dès lors que les autres déterminants politiques et macro-économiques ne laissent pas s’accumuler d’irréparables tensions entre pays, venant entraver ensuite sa progression.

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits