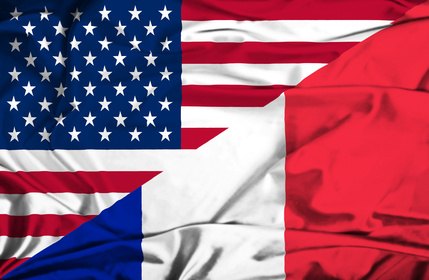Les appels à la réforme du management en entreprise se font de plus en plus prégnants. Ce management, malade de la mesure et de la recherche d’une certaine efficacité à tout prix, est appelé à panser ses maux pour se mettre à hauteur d’homme.
Décrié pour sa propension à mettre en gestion les individus au travers d’artefacts obstruant toute singularité, à confondre moyen et finalité, réflexe et réflexion, temps long et temps court, le management est appelé à se renouveler pour faire coïncider les aspirations humaines et les enjeux organisationnels et économiques. En effet, vecteur de mal-être au travail, de burn-out, de bore-out, de perte de sens et plus tragiquement de suicides, la crise du coronavirus a montré, dans le temps long, qu’un management hémiplégique pouvait concourir à une crise systémique par le bais d’externalités issues de différents inducteurs « sous management » (biodiversité, hôpitaux, recherche…).
Malgré une volonté de réforme d’une part non négligeable des professionnels de l’entreprise (chercheurs, managers, consultants), les réalités ne changent guère. Tout se passe comme-ci la volonté d’agir se heurtait à un manque de méthodes ou d’outils pour s’emparer d’une réalité complexe afin de construire des modalités nouvelles de l’action collective plaçant l’humain avant le reste.
Nous pensons pour notre part que toute réforme du management passe d’abord par la déconstruction des fictions qui constituent le soubassement idéologique des pratiques décriées. En effet, il nous semble vain de penser le management sans écailler les certitudes qui concourent à une philosophie gestionnaire simpliste, utilitariste et contreproductive à long terme.
Dans cette optique, nous proposons dans les lignes suivantes, de questionner quelques fictions en vigueur dans l’entreprise, un prélude à toute rupture avec des automatismes mentaux, verbaux qui sont autant de vecteurs de prescriptions à l’action et autant d’obstacles à une pensée complexe et à un agir réellement humain. Nous traiterons ci-après de trois fictions que sont le marché du travail, la culture d’entreprise et la performance.
Le marché du travail
« Vendre sa force de travail » suppose qu’il y ait un marché du travail, un marché de la main d’œuvre ou un marché du cerveau d’œuvre. L’existence d’un tel marché est ancrée dans l’imaginaire collectif comme une évidence, comme une espérance pour des millions de personnes en quête de travail mais surtout comme un des leviers clés du système de production de biens et de services, moteur de l’économie. Les effets d’un tel « marché » du travail finissent par occulter son caractère fictionnel.
En effet, le marché du travail fait partie des trois fictions constituantes de l’économie (capitaliste) de marché avec la terre et la monnaie. Comme le précise Polanyi, l’économie de marché ne peut fonctionner que si et seulement si, le travail, la terre et la monnaie sont considérés comme des marchandises alors qu’ils ne le sont aucunement : « Le point fondamental est le suivant : le travail, la terre et l’argent sont des éléments essentiels de l’industrie ; ils doivent eux aussi être organisés en marchés ; ces marchés forment en fait une partie absolument essentielle du système économique. Mais il est évident que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises ; en ce qui les concerne, le postulat selon lequel tout ce qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux. En d’autres termes, si l’on s’en tient à la définition empirique de la marchandise, ce ne sont pas des marchandises. Le travail n’est que l’autre nom de l’activité économique qui accompagne la vie elle-même – laquelle, de son côté, n’est pas produite pour la vente mais pour des raisons entièrement différentes –, et cette activité ne peut pas non plus être détachée du reste de la vie, être entreposée ou mobilisée ; la terre n’est que l’autre nom de la nature, qui n’est pas produite par l’homme ; enfin, la monnaie réelle est simplement un signe de pouvoir d’achat qui, en règle générale, n’est pas le moins du monde produit, mais est une création du mécanisme de la banque ou de la finance d’État. Aucun de ces trois éléments – travail, terre, monnaie – n’est produit pour la vente ; lorsqu’on les décrit comme des marchandises, c’est entièrement fictif ».
« Vendre sa force de travail », c’est donc vendre plus que son travail, c’est un engagement de son être tout entier : c’est accueillir des exigences sur une existence.
Ainsi, bien que fictionnel, le travail comme marchandise sans vision holistique de l’Homme produit des effets concrets dans l’entreprise. Il se décline en un maniement des hommes obstruant toute prise en compte de la complexité de l’être. Dès lors, la raison instrumentale, au prix d’une efficacité apparente, cantonne le travailleur au rang d’abstraction chiffrée. Ce qui faisait dire à Simone Weil, la philosophe, que « les machines ne fonctionnent pas pour permettre aux hommes de vivre, mais qu’on se résigne à nourrir les hommes afin qu’ils servent les machines ». L’homme-ressource ainsi obtenu peut être « manipulé » dans un processus de production de biens et/ou de services dont il ne sera qu’une ressource parmi d’autres, configurables au gré de scénarios tendanciels de ventes.
Nous finissions par oublier que l’engagement de l’homme au travail nécessite une contrepartie : un « commerce de la considération » (Michel Volle) pour aligner tant soit peu les sens individuels des travailleurs au grand sens découlant ses objectifs de l’entreprise. Un tel commerce de la considération passe par la mise au ban du tout prescriptif, du tout procédure pour laisser place à des espaces de respiration afin de réintroduire le conflit (« dans le sens conflit de critères sur le travail bien fait ») comme moyen d’instruction de la qualité du travail et du partage du sens. En effet, il ne suffit pas d’être reconnu par quelqu’un, encore faut-il se reconnaitre dans quelque chose (Yves Clot). Le travail comme marché permet que l’on soit reconnu par quelqu’un (au moins par le recruteur…) mais seule la prise en compte de l’homme dans sa totalité, dans la richesse de sa singularité, peut lui donner les outils capables de lui permettre de se reconnaitre dans son travail. Concrètement, cela consiste à réinterroger le mode de production du travail au-delà des mesures habituelles d’accompagnement pour remettre en question la rationalisation forcée et le corsetage total du collaborateur. Cette rationalisation forcée, outre le fait qu’elle déresponsabilise les individus et leur obstrue toute capacité de prise d’initiatives, représente un risque majeur pour les organisations étant donné que le travail prescrit d’en haut ne pourra jamais totalement coïncider avec le travail vécu. Réintroduire la capacité des travailleurs à négocier avec le « réel » est donc un gage de réussite pour l’entreprise et une condition nécessaire pour que les individus aient le sentiment de concourir à une œuvre. C’est pourquoi la philosophe Simone Weil voyait dans l’initiative et la responsabilité, le sentiment d’être utile et même indispensable, des besoins vitaux de l’âme humaine.
En résumé, pour que la fiction du marché du travail soit opérante à bon escient, l’entreprise doit dépasser le biais utilitariste pour appréhender l’homme comme un tout dans sa complexité. C’est le prix de la soutenabilité de son développement.
La culture d’entreprise
La notion de culture en entreprise est un emprunt à des disciplines comme l’anthropologie, la sociologie, la philosophie. Comme bien souvent en entreprise, de tels emprunts issus de disciplines autres, obéissent à ce que j’appellerais l’extrapolation hyperbolique de concepts ou de pratiques dans une visée instrumentale. De telles extrapolations hyperboliques à visée instrumentale sont productrices de faits stylisés voire de faits fossilisés qui font que « toute ressemblance à la réalité serait une pure coïncidence ». La « culture d’entreprise » n’y échappe pas.
D’abord, la notion de culture d’entreprise est trompeuse. Si nous entendons par culture, un ensemble de références partagées dans une organisation et résultant d’un processus d’apprentissage organisationnel (Thévenet), nous ne pouvons pas à proprement parler de culture d’entreprise mais de cultures au pluriel car les références partagées dépendent largement de l’histoire individuelle, de l’histoire de l’entreprise, de la position et du métier dans l’entreprise. Ainsi, Sainsaulieu voyait dans l’entreprise, la cohabitation de plusieurs cultures issues de différentes catégories professionnelles : la culture des ouvriers spécialisés et des travailleurs non qualifiés ; la culture des techniciens et des cadres de métier ; cadres autodidactes et des techniciens généralistes ; la culture des ouvriers déqualifiés dépourvus de mémoire ouvrière. Chaque culture a ses propres spécificités et son propre rapport au travail, tout cela s’inscrivant bien sûr dans des trajectoires personnelles et se manifestant dans différents schémas comportementaux dans l’entreprise. Par ailleurs, les différences de cultures au sein d’une même entreprise peuvent engendrer des chocs dont les expressions peuvent être plus ou moins violentes notamment sur le plan symbolique.
D’autre part, la culture est mobilisée pour résoudre des problèmes de management, de fusion-acquisition, de conduite du changement… Elle est appréhendée comme un objet qu’on peut isoler, cerner, mobiliser, piloter, mesurer ; une telle tentative de mise en gestion permettrait de « minimiser » les risques d’échec d’une transformation, d’un projet stratégique ou de toute autre aventure managériale. Cette instrumentalisation de la culture est vaine voire contreproductive. Comme le précise Thévenet, une telle mise en gestion comporte au moins deux faiblesses : « La première faiblesse concerne la méthodologie. Les ethnologues nous ont appris depuis longtemps les difficultés méthodologiques de la mise en évidence d’une culture et au niveau de l’entreprise, on a souvent cru pouvoir rapidement mettre en évidence des traits culturels qui n’en étaient pas. Dans la pratique on a pu appeler analyse de culture ce qui n’était qu’un état de l’opinion. On mettait en évidence de supposées valeurs qui relevaient plus de la valeur déclarée que de l’opérante, c’est-à-dire celle qui fonde réellement des comportements, des pratiques de gestion et des visions du monde. La seconde faiblesse est de générer des politiques dont l’histoire nous avait pourtant enseigné qu’elles étaient au mieux inefficaces, au pire nuisibles…Evidemment on comprend le rêve tellement humain de rêver une organisation parfaite, en phase avec les idées d’un dirigeant, d’un groupe d’actionnaires ou d’une équipe managériale mais tous les rêves ne sont pas réalisables et l’approche mécaniste de la culture a pu ainsi conduire à en oublier la plus petite parcelle de bon sens anthropologique ».
Instrumentaliser la « culture d’entreprise » pour faire arrimer les individus strictement aux tâches prescrites en dehors de toute concertation peut avoir paradoxalement des effets dévastateurs sur l’efficacité de l’entreprise. En effet, la souffrance au travail (et donc la perte d’efficacité qui en découle) est souvent liée à la perte du pouvoir d’agir et à l’inexistence des espaces de délibération collective (Yves Clot).
Au-delà des faiblesses praxéologiques d’une mobilisation de la « culture d’entreprise » non pas pour tenter comprendre la complexité du réel mais pour agir directement sur ce dernier, mobiliser « la culture d’entreprise » au moment où toutes les transformations mènent à une entreprise « sans feu ni lieu » c’est-à-dire une entreprise sous la forme d’une collection d’individus coordonnée par un réseau informatique, cela peut sembler incongru. En effet, la culture d’entreprise renvoie aux références partagées et au temps long ; ce sont aujourd’hui deux dimensions que remettent en cause les nouvelles formes et outils du travail (travail à distance, organisation en réseaux, consultants indépendants, individualisation des « performances » et des récompenses, contrat de mission, intérim…).
La fiction de la culture d’entreprise comme objet de gestion est ancrée dans l’entreprise et nous avons vu toutes les limites d’une telle conception. Néanmoins, penser la culture de l’entreprise ou les cultures de l’entreprise a une vertu, celle de donner à penser l’entreprise comme une institution (nous parlons désormais de raison d’être des entreprises) qui dépasse largement sa seule utilité productive et qui sur un territoire doit jouer un rôle politique dans le sens premier du terme.
La performance
S’il y a bien un mot qui caractérise aujourd’hui les entreprises et plus largement les organisations, c’est bien la notion de « performance ». Etymologiquement, la performance renvoie aux « résultats, actions accomplies par un cheval de course ». Son utilisation pour qualifier les performances humaines est du registre de la catachrèse.
Aujourd’hui, c’est un mot polysémique qui décrit le succès, l’action accomplie mais aussi le résultat de l’action. La performance apparait donc comme un concept-monde c’est-à-dire un agrégat de concepts dont l’interprétation globale renvoie à une philosophie gestionnaire dont le soubassement est la rationalité instrumentale. Elle est mobilisée dans presque toutes les séquences organisationnelles pour en définir l’ordre gestionnaire. Ces séquences organisationnelles ne sont bien sûr pas exsangues de fictions. En voici deux illustrations :
La performance par l’individualisation des objectifs et des récompenses : « chacun pour soi et l’entreprise pour tous » pourrait être la traduction « vulgaire » de l’individualisation des objectifs et des récompenses. Ce dispositif a pour objectif de « responsabiliser » les collaborateurs et d’améliorer la performance. A défaut d’une supervision directe pour lutter contre la flânerie systématique (Taylor), l’individualisation des objectifs et des récompenses a une fonction d’intériorisation qui permet le contrôle constant des attitudes et donc de l’implication au travail. Cette autonomisation n’est pas sans conséquence puisqu’elle renforce le poids de la charge mentale (Hamon-Cholet et Rougerie) c’est-à-dire le risque d’une dégradation des conditions de travail et in fine de la performance. Au-delà de ce premier biais de l’individualisation des objectifs et des récompenses, ce dispositif nourrit une injonction paradoxale. En effet, quoi de plus étonnant lorsqu’on place l’intelligence collective, la collaboration comme sources d’innovation et de performance, d’agir concomitamment avec un tel dispositif qui au-delà de créer de la charge mentale chez les collaborateurs, les incite à spéculer sur la force civilisatrice de l’hypocrise pour tirer, symboliquement et financièrement, leur épingle du jeu …
La performance par les chiffres : « Si les faits sont les faits, les données ne sont pas données », cet adage devrait être la morale de tout bon professionnel des chiffres. En effet, le romantisme des chiffres fait perdre de vue la polysémie du réel et nous sommes souvent enclin à prendre les données pour des faits d’autant plus que nous agissons souvent sous la contrainte du temps.
Ce biais par facilité n’est pas sans conséquence concrète : nous finissons par penser que dans l’action collective, ce qu’on ne peut pas traduire en chiffres, justifier en chiffres n’existe pas. Le chiffre devient ainsi le signifiant et le signifié et ne laisse aucune place au récit, à l’expression des sentiments, au contexte ou à toute narration porteuse de sens. C’est une situation ubuesque voire ironique d’autant plus qu’au même moment, la perte de sens au travail semble être une des causes du désengagement en entreprise. C’est ainsi qu’un hôpital mis sous management et expurgé de tout ce qui ne peut pas être chiffré c’est-à-dire de tout ce qui fait l’essence du soin, devient assimilable à un hôtel et donc « géré » comme tel avec les conséquences dramatiques qui en découlent. Oui, à un certain niveau de rationalisation, il n’y a plus de différence entre un hôtel et un hôpital malgré l’avertissement de Jacques Prevert : le monde mental ment monumentalement. L’exactitude n’est pas la vérité.
La performance est donc une des fictions pratiques qui cristallise le plus les tiraillements entre le « je » (l’être) et le « jeu » (les règles de l’entreprise). C’est d’ailleurs ce qui fait la force du mot. En son nom, on euphémise pour faire passer sous le manteau les injonctions paradoxales quotidiennes au travail. C’est un mot qui dissimule les impensés fondamentaux de l’entreprise moderne : la vérité de l’être et le prix du court-termisme.
Pour conclure, nous pouvons dire que questionner les fausses évidences en entreprise pour alerter sur leurs incidences concrètes constitue la première brique d’une réforme du management. En effet, les fictions que nous venons de passer en revue bien que de nature différente instituent l’homme placé dans un lien de dépendance juridique par le contrat (de travail) comme un simple agent économique. Un homme ainsi diminué n’en est plus un. Toute demande d’efforts durables à un homme nécessite qu’il soit considéré comme tel. Pour ce faire, il faut introduire en miroir du lien de subordination, fiction juridique par excellence, la dignité dévolue à chacun, c’est-à-dire, ne jamais être considéré comme moyen mais toujours comme finalité. Cela passe par un travail de qualité, dans un environnent de qualité, dans une perspective de développement de qualité.
Concrètement, cela nécessite une « diplomatie des disciplines » pour d’une part, déconstruire les fictions managériales à la lumière des corpus de connaissances disponibles en sociologie, en psychologie du travail et des organisations, en anthropologie, bref tout corpus de connaissances pouvant éclairer l’action collective ; d’autre part, pour enrichir le corpus de connaissances en management (charge sémantique, symbolique et concrète). Une telle entreprise a un double objectif : réintroduire de la complexité c’est-à-dire la réalité dans la compréhension de l’action collective en entreprise ; user de cette complexité non pas comme un frein à l’action mais comme le lit de toute action ancrée dans le temps et productrice de sens.
Cette diplomatie des disciplines nous permet notamment de savoir que lorsqu’une entreprise est traversée par des risques psycho-sociaux (RPS), il ne suffit pas juste de favoriser la qualité de vie au travail (QVT) : babyfoot, cantine Bio, salles de repos etc… Il faut surtout favoriser la qualité du travail (les critères de qualité du travail et la qualité du collectif notamment). En effet, la psychologie du travail et des organisations (sa pratique clinique de l’activité en l’occurrence), nous apprend que les RPS peuvent aussi renvoyer aux « ressources psychologiques et sociales » (Yves Clot) capables d’armer les collaborateurs face à des situations à risques pour leur santé psychique et par conséquent, elles ne sont pas à supprimer mais à développer. On passe dès lors d’une vision défensive par la gestion des risques (vision qui participe à la fiction du tout « gérable ») à une vision plus dynamique basée sur le développement des aptitudes (ressources à mettre à disposition pour l’action). Cet enrichissement de la perspective qui questionne une évidence comme les risques psycho-sociaux n’est possible que grâce à la diplomatie des disciplines.
Questionner les « certitudes » du management, c’est donc lutter contre l’entropie qui se nourrit d’une quête d’efficacité érigée en dogme et basée par des fictions au détriment de la complexité de l’action collective.
<<< À lire également : Sondage Exclusif: Les Entreprises Sont-Elles A La Hauteur De La Crise ? >>>

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits