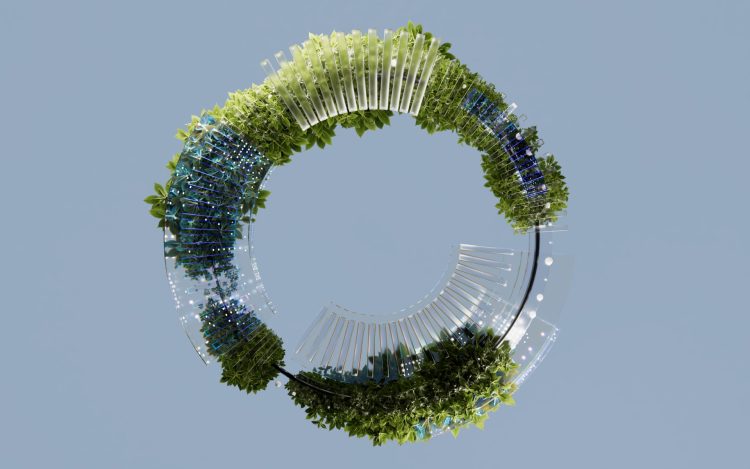Donald Trump avait annoncé qu’il allait tout changer. S’il s’est fait railler en affirmant qu’il mettrait fin à la guerre en Ukraine en une journée, son appel téléphonique ce 12 février avec Vladimir Poutine est un renversement de l’ordre westphalien traditionnel des relations internationales.
Une contribution de Samuel Furfari, Professeur de géopolitique de l’énergie
En matière d’énergie, la tornade Trump n’a pas tant révolutionné la géopolitique de l’énergie, car tout était déjà en place avant son arrivée, mais elle a bouleversé la communication autour de cette géopolitique énergétique. Il a remplacé la fierté verte par la fierté des hydrocarbures. Ceux qui croyaient naïvement que le monde allait abandonner les énergies fossiles pour se plier aux injonctions climatiques de l’UE se sont lourdement trompés. Les COPs ont déjà intégré ce fait : le pétrole et le gaz naturel resteront incontournables tout au long de ce siècle. Il vaut donc mieux veiller à leur transport sûr et respectueux de l’environnement, car « Drill, baby, drill » (NDLR : en français, creuse, bébé, creuse} ne suffit pas, il faut aussi acheminer les énergies fossiles du producteur aux consommateurs.
Quand les sanctions font tanguer le marché de l’assurance maritime
Si l’essentiel de la guerre en Ukraine se joue sur terre, on sait qu’il existe une dimension maritime au conflit. Celle-ci n’est cependant pas uniquement militaire. Elle ne l’est même pas essentiellement… L’essentiel est ailleurs : il a trait à l’économie. Souvenez-vous des difficultés liées au transport des céréales et des engrais dès le début de la guerre.
Le 13 octobre dernier, un navire transportant du gaz de pétrole (GPL) battant pavillon tanzanien, le Captain Nikolas, prenait feu lors d’un transbordement au large du Bangladesh. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident et pour vérifier s’il appartenait bien à la « dark fleet ». Mais pour l’armateur la sentence est déjà tombée : son assurance maritime, souscrite auprès d’un courtier spécialisé, qui avait revendu la police à un grossiste, qui l’avait lui-même cédé à un autre assureur s’est révélée inexistante… Impossible à appeler en garantie.
Voilà la réalité que l’on feint d’ignorer, après plus de deux ans de guerre en Ukraine : le coût des assurances, pour le fret maritime, a été multiplié par 10, parfois même par 20. Les grands assureurs internationaux, notamment anglais, mais aussi russes, se retirent du marché de peur des sanctions occidentales, laissant la place à des assureurs alternatifs trop peu capitalisés ou même, comme dans le cas du Captain Nikolas, évanescents… Conséquence, des centaines de méthaniers, pétroliers, chimiquiers, qui présentent le plus de risques en cas d’accident ou d’attaque terroriste, naviguent — à l’instar de chauffards sur nos routes ― peut-être sans être assurés et ils ne le savent pas, ou ne veulent pas le savoir.
Le spectre d’une catastrophe écologique et économique
Les voies maritimes reliant les zones de production de gaz et de pétrole brut aux pays consommateurs sont comme le système sanguin du globe : ils irriguent l’économie mondiale en énergie. Le détroit d’Ormuz, la mer Rouge, le golfe d’Aden, le détroit de Malacca, appelés dans le jargon géopolitique « World Oil Transit Chokepoints » : tous ces sites, stratégiques pour l’approvisionnement énergétique de tous les pays importateurs, sont soumis à de fortes tensions. En mer Rouge, les attaques des groupes rebelles Houthis ont fait flamber les primes d’assurance des grandes compagnies, qui refusent à leurs clients de couvrir le risque, et leur imposent de passer par le Cap de Bonne Espérance. Et tant pis si le contournement de l’Afrique par le sud prend une semaine de plus et, par conséquent, coûte plus cher et pollue davantage. Ces navires n’ont pas d’autre choix.
Parallèlement, les sanctions occidentales contre la Russie et l’Iran, en interdisant aux grands assureurs de couvrir certains types de cargaisons, ont totalement déstructuré un secteur autrefois stable, fiable, responsable. L’embargo européen sur le pétrole russe a laissé un vide qu’une myriade d’acteurs marginaux et douteux s’est empressée de combler.
Ce qui est arrivé à l’armateur du Captain Nikolas n’est pas un cas isolé. Dès lors, on comprend aisément que ceux qui sont mal ou pas assurés, et qui le savent parfaitement, fassent tout pour que cela ne se sache pas…
Entre nécessité et vulnérabilité
Les sanctions occidentales interdisant de fournir des services connexes au pétrole russe vendu à plus de 60 dollars le baril ont entraîné l’apparition de ce qu’on a pris l’habitude d’appeler une « flotte fantôme » : des centaines de navires mal identifiés, souvent âgés de plus de 15 ans, sillonnent désormais les mers et océans du globe. Ces quelque 600 navires transporteraient jusqu’à 1,7 million de barils de pétrole par jour. Si certains experts affirment que le principal problème de ces navires est leur ancienneté, leur point de vue doit être nuancé. L’âge moyen de la flotte clandestine russe ne dépasserait en réalité que de quelques années l’âge moyen de la flotte mondiale. Le véritable problème réside plutôt dans les polices d’assurance souscrites par les armateurs de ces navires : si elles leur permettent d’obtenir des certificats de navigation, ceux-ci ne valent guère plus que le papier sur lequel ils sont imprimés… En cas d’incident ou d’accident, l’absence de garanties adéquates expose non seulement les équipages, mais aussi les mers et les côtes au large desquelles ils croisent à des risques importants.
Les conséquences potentielles de cette situation sont connues. Lors du naufrage de l’Erika en 1999 au large de la Bretagne, le Fonds d’indemnisation des pollutions, et l’assureur du navire ont versé des indemnités. Mais en cas de marée noire au large de la Namibie, de la Sierra Leone ou du Liberia, personne ne réglera les millions d’euros indispensables au nettoyage des côtes. Personne n’indemnisera les dizaines de milliers d’habitants des côtes polluées pour longtemps ni les pêcheurs de ces régions. Les pays frappés par un tel accident se retrouveront seuls, condamnés à espérer une hypothétique aide de l’ONU.
La désorganisation du transport d’hydrocarbures en cas d’accident, ou pire, d’attaque et destruction délibérée d’un pétrolier ou d’un méthanier pourrait aussi déstabiliser les marchés, et affecter l’économie mondiale. Les conséquences désastreuses de la récente augmentation du prix de l’énergie sur les ménages français et les usines allemandes devraient être méditées.
Plus d’hydrocarbures impliquent plus de sécurité
Le temps presse. La crise de l’assurance dans le secteur du transport maritime n’est pas une question de second plan ; elle affecte directement la sécurité, l’économie et l’environnement à l’échelle globale. Les gouvernements et les institutions internationales doivent se mobiliser pour réguler ce secteur, désorganisé et fragilisé par des sanctions mal calibrées. Cela nécessite de mieux ajuster les mécanismes de sanctions pour garantir la solvabilité des assureurs et la fiabilité des acteurs impliqués, comme les courtiers et les intermédiaires qui font partie de la chaîne.
Avec l’inexorable croissance de la demande en pétrole et gaz naturel, le transport énergétique sera plus vulnérable aux congestions et donc susceptible de catastrophes. Si nous voulons protéger non seulement notre économie, mais aussi nos écosystèmes et la stabilité mondiale, il est impératif que la communauté internationale agisse pour sécuriser les routes de l’énergie.
N’en déplaise aux tenants de la décroissance, adorateurs du déclinisme, pour faire face aux défis qui sont devant nous (crise des dettes souveraines, bataille pour la réindustrialisation, tsunami du quatrième âge…), il faut impérativement que l’énergie circule librement ! En plus de « drill baby drill », Donald Trump devrait lancer « Sail, baby sail ».
À lire également : L’UE annonce des contre-mesures contre les droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits