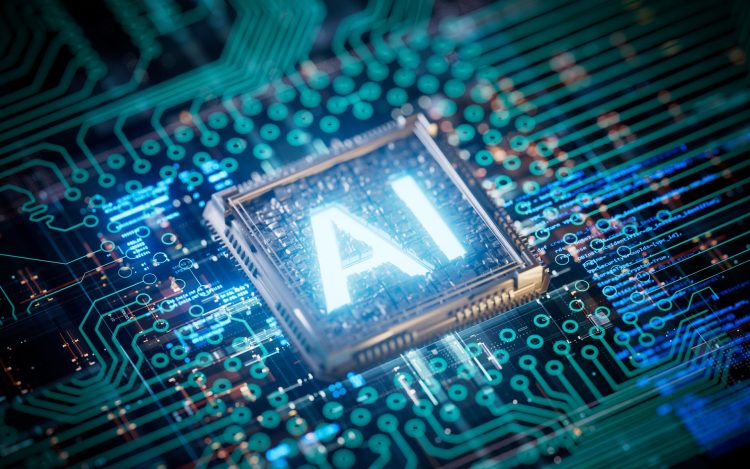Avec la mise à exécution des nouveaux droits de douane, les contours d’un plan plus large de la part de l’administration américaine se dessinent. L’objectif étant d’affaiblir le dollar, en prenant le risque de remettre en cause son statut de monnaie de réserve. Une stratégie périlleuse.
Une contribution de Benoît Peloille, CIO – Natixis Wealth Management
Le dollar, bouc émissaire de la désindustrialisation
Donald Trump et son entourage en sont convaincus, la force du dollar est la raison de la désindustrialisation du pays. Considérée comme surévaluée, la devise américaine rend ainsi les produits américains trop chers à l’étranger et stimule la consommation, nourrissant l’immense déficit commercial des Etats-Unis. Lors de l’audition du président de la Réserve Fédérale Jérôme Powell devant les sénateurs en 2023, J. D. Vance avait clairement questionné l’intérêt d’un dollar fort considérant le statut de réserve de valeur comme une « subvention massive au bénéfice des consommateurs et au détriment des producteurs américains ». Le privilège exorbitant du dollar, acquis durant plus d’un siècle de construction institutionnelle et de coopération internationale, consacrant la puissance des Etats-Unis au sortir de la seconde guerre mondiale et pilier des échanges internationaux étant, selon lui, le moyen « d’une consommation de masse de produits importés inutiles ». Le pouvoir d’entretenir des déficits commerciaux sans risque, mais aussi de financer aisément des déficits publics considérables, est aujourd’hui considéré comme le boulet de l’économie américaine et la cause de la désindustrialisation.
La baisse du dollar, de gré et surtout de force
Ainsi, il faut faire baisser la devise américaine, de gré ou de force, en mettant un terme au privilège exorbitant américain s’il le faut. Les barrières douanières sont si importantes pour la nouvelle administration Trump car elles sont l’outil préalable au service de cet objectif. Elles vont notamment de pair avec le retrait du soutien militaire et la promesse de sécurité offerte par Washington. L’objectif est d’exercer une intense pression pour contraindre les partenaires commerciaux des Etats-Unis d’accepter de nouveaux accords monétaires, afin d’organiser une baisse coordonnée de la devise américaine. Consciente évidemment du rôle joué par ce statut de réserve de valeurs dans la possibilité d’un endettement public sans limite, cette administration est convaincue de pouvoir financer son déficit par les recettes obtenues par les taxes douanières. Plus inquiétant, ces nouveaux accords monétaires comprendraient une forme d’échange de dette avec les partenaires commerciaux des Etats-Unis afin d’éviter la hausse des taux d’intérêts.
Une stratégie peu orthodoxe et périlleuse
Peu de pays dans le monde se priverait volontairement du privilège qu’offre le statut du dollar dans les échanges internationaux. Mais plus fondamentalement, le rôle joué par l’appréciation du dollar dans les déficits commerciaux américains n’est pas exclusif. Ces déficits sont surtout le signe d’une économie riche et dynamique et sont ainsi le symbole de la croissance insolente des Etats-Unis par rapport au reste du monde depuis la sortie de la pandémie. Alors que la plupart des économies du monde ont atterri sous l’effet des hausses de taux, l’économie américaine est parvenue à maintenir une croissance quasi systématiquement supérieure à son potentiel, signe de plein emploi. Par ailleurs, ils reflètent également une spécialisation industrielle qui fait envie au reste du monde. La désindustrialisation des Etats-Unis s’est réalisée au bénéfice de la technologie qui est une des raisons de l’exceptionnalisme américain. Leaders mondiaux de l’innovation, les Etats-Unis bénéficient de gains de productivité qui font pâlir d’envie le reste du monde développé. Ce n’est pas une désindustrialisation, mais une montée en gamme. L’économie américaine est ainsi la preuve que les gains de productivité sont possibles, même à l’ère post industrielle. Enfin, le fondement même d’une telle stratégie pose question. Pourquoi cette obsession de la réindustrialisation ? Les Etats-Unis n’échappent pas au vieillissement démographique et cette spécialisation disproportionnée en faveur des services reflète simplement la consommation d’une population vieillissante qui a plus besoin de services à la personne que biens manufacturés.
Quels partenaires accepteraient un tel traitement ?
Pour illustrer les plans de l’administration Trump, on se réfère souvent aux accords du Plaza de 1985. Mais la situation est bien différente. A l’époque le dollar apparaissait consensuellement surévalué et contribuait aux déséquilibres globaux. Les pays signataires des accords vivaient encore dans le traumatisme de l’inflation et accédaient volontiers à l’argument de renforcer volontairement leur monnaie afin de limiter le danger de l’inflation importée. Désormais, la plupart des pays partenaires des Etats-Unis sont en passe de retrouver la maîtrise de l’inflation et sont des économies qui dépendent fortement du commerce extérieur. Une remontée de leur devise irait à l’encontre de leurs intérêts. Par ailleurs, le désengagement militaire américain a été l’occasion de se mobiliser ailleurs, particulièrement en Europe où les états avancent vers une défense commune et plus intégrée, dégageant des moyens considérables qui vont stimuler la croissance des prochaines années. Enfin, quel pays accepterait de financer quasiment gratuitement et à perpétuité un « partenaire » sous la contrainte tout en faisant supporter à sa population des réformes douloureuses afin de maîtriser son propre déficit et sa dette… ? Une telle stratégie pourrait en réalité générer une crise budgétaire aux Etats-Unis… Comment ne pas considérer un tel échange de dette comme un évènement de crédit, constitutif d’un défaut ?
À lire également : Droits de douane : l’incertitude nuit à l’économie et aux investisseurs
Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook
Newsletter quotidienne Forbes
Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits