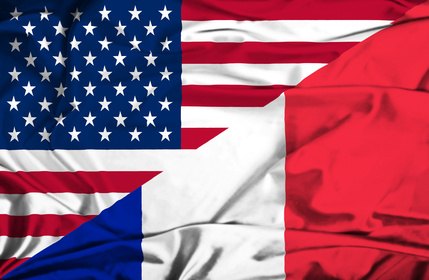Se remémorer une histoire partagée, qu’elle soit bonne ou mauvaise, a toujours constitué un moteur relationnel et social fort, que l’on soit en couple, en famille, entre amis ou même entre concitoyens. Se rappeler ce que nous avons été confère au présent partagé de la substance, du sens et nourrit aussi l’envie de continuer. Cette culture de la mémoire est tellement évidente et diffusée, qu’elle ne souffre aucune polémique.
Un article écrit avec Barbara Carrière et Nicolas Bartel d’Eurogroup Consulting
Ce travail de mémoire, si communément accepté, ne franchit que très peu les portes de l’entreprise. Dans une très grande majorité des organisations, l’oubli fait loi : on oublie les chiffres, on oublie les succès et les défaites, on oublie les projets, le pourquoi des pratiques, on oublie les femmes et les hommes d’hier afin de focaliser toute l’énergie sur aujourd’hui et demain. Le « tomorrow is another day » d’une Scarlett O’hara résolument optimiste et résiliente à la fin d’Autant en emporte le vent devient la règle, une sorte de mantra managérial compris de toutes et tous, voire revendiqué.
S’il nous apparait évident que l’oubli et l’amnésie corporate trouvent leur source dans l’idée d’une projection facilitée et allégée vers un futur que l’on veut meilleur (et non dans une forme inconsciente et généralisée d’une culture du déni), on peut néanmoins se poser la question suivante : faire table rase du passé avec cette idée d’une page blanche où tout est possible et rien n’est interdit, n’est-elle pas in fine totalement illusoire ?
Le bien meilleur monde d’après : réalité, idéologie ou envie ?
Au cœur des dynamiques organisationnelles, nous trouvons systématiquement l’idée d’un développement positif, continu et donc porteur d’améliorations (pour le collaborateur, le client, l’agent, le citoyen…). Le rapport au temps des organisations s’articule autour de l’idée communément admise que demain se doit d’être meilleur qu’aujourd’hui. L’impératif progressiste s’impose à tous et contraint dirigeants et collaborateurs à aiguiser leur projection stratégique et leur esprit d’innovation pour préparer au mieux un demain que l’on souhaite prometteur. Cette vision résolument optimiste du futur, « d’un monde d’après meilleur » induit une vision faussée d’un monde d’avant qui serait donc « moins bien » voire pour certains « mauvais » et donc d’un intérêt tout relatif.
Cette vision d’un passé qui n’aurait finalement que peu d’intérêt, car révolu en regard d’un monde en constante évolution est par ailleurs renforcée par la représentation que l’on se fait du temps en entreprise : un segment borné avec un début et une fin qui possiblement peut lui-même se décomposer en sous segments (l’année fiscale, le trimestre, le mois, la semaine, etc.)
Cette focale mise sur le futur, assortie d’une vision d’un temps résolument fini, rend extrêmement difficile l’exercice de mémoire : l’effort est tout entier porté sur le point d’arrivée, et s’interroger sur ce qu’il y avait « avant » devient quasiment un sujet d’ordre métaphysique. On pourrait même parfois avoir l’impression qu’avant le lancement de la nouvelle année fiscale, du kick off du projet ou de la présentation de la feuille de route prédominaient le vide et le rien.
L’importance de la narration
L’auteur Yuval Noah Harari (Sapiens, une brève histoire de l’humanité, 2015, Albin Michel) affirme que l’histoire, c’est le premier système d’information d’un collectif. L’histoire, c’est ce qui fonde le collectif de par un héritage qu’il doit préserver et développer. La notion d’héritage ne doit pas être comprise comme une vision passéiste, mais constitutive d’une identité et donc d’un projet au regard de cette dernière. Raconter l’histoire d’une entreprise, c’est témoigner de ses moments forts qui sont à l’origine de son identité et de sa singularité qui sont à la fois des éléments de différenciation sur les marchés et d’engagement pour les collaborateurs. Cela peut prendre différente forme comme l’écriture d’un livre ou la production d’un film. Mais certaines entreprises constituent des musées comme c’est le cas dans l’automobile. Comme le mentionne la maxime « Regarder dans le rétroviseur de l’histoire, ne nous éloigne en rien de la trajectoire future ». Au contraire, la mémoire alimente cette trajectoire future et lui donne une épaisseur (un contenu plus fort).
À lire également : Extra Mind : de l’importance des marges de manœuvre pour des meilleures relations au travail

Abonnez-vous au magazine papier
et découvrez chaque trimestre :
- Des dossiers et analyses exclusifs sur des stratégies d'entreprises
- Des témoignages et interviews de stars de l'entrepreneuriat
- Nos classements de femmes et hommes d'affaires
- Notre sélection lifestyle
- Et de nombreux autres contenus inédits